Loin des centres urbains de prise de décision, les éleveurs et les populations rurales avec lesquelles ils partagent l’espace ont souvent peu de voix dans le gouvernement étatique. Ces populations sont confrontées à des obstacles en ce qui concerne la participation aux institutions publiques, l’expression de leurs préoccupations dans un langage adapté aux politiques et l’assurance liée au fait que leurs intérêts sont représentés. Cependant, les pasteurs qui cherchent à protéger leurs libertés des autorités centrales peuvent ne pas considérer les mesures politiques comme une solution, voir le gouvernement comme leur allié, ou considérer le manque de participation civique comme un problème. La plupart des pasteurs trouvent que leurs intérêts sont mieux servis par des réseaux de pairs de longue date ou des institutions coutumières, plutôt que par les gouvernements centralisés que l’on trouve dans de nombreux États de la région soudano-sahélienne. Les interventions qui renforcent les institutions étatiques au niveau local ou national, connues pour négliger les préoccupations des éleveurs, risquent d’inciter à une plus grande polarisation.
Les tensions entre les communautés pastorales et les autorités centrales ont un long héritage historique, qui commence avec la gestion coloniale des terres et se poursuit après l’indépendance. Si les politiques foncières et les contrôles frontaliers de certains États ont été révisés ou remplacés par une législation qui protège les moyens de subsistance des éleveurs, cet héritage d’hostilité à l’État n’est pas vite oublié. Ces soupçons sont confirmés lorsque les États imposent des taxes sur la traversée des frontières, restreignent les mouvements pastoraux ou privatisent les terres publiques. Contourner le contrôle de l’État en évitant les postes de contrôle frontaliers ou en rejetant les systèmes de délivrance de permis pour le bétail sont des pratiques fréquentes. Cette non-conformité, à son tour, alimente les stéréotypes sur les pasteurs en tant que criminels.
Accroître la représentation des communautés pastorales dans les institutions de l’État peut contribuer à apaiser ces tensions, mais ce n’est pas toujours faisable. Les pasteurs maliens qui migrent au Nigéria sont directement affectés par les politiques nigérianes, mais n’auront pas les mêmes possibilités qu’ont les citoyens nigérians d’influencer la prise de décision politique.
Dans de nombreuses régions, les groupes pastoraux constituent une minorité démographique extrême qui est confrontée aux mêmes obstacles à l’inclusion que tout autre groupe minoritaire, mais ces obstacles sont aggravés par leur mode de vie qui les tient éloignés des centres politiques.
Pourtant, le problème de l’exclusion varie selon les contextes. Dans certaines sous-régions, les groupes ethniques pastoraux englobent de grandes et d’influentes circonscriptions politiques qui dominent la politique locale, même s’ils sont minoritaires au niveau national. Il s’agit d’une préoccupation pour les communautés agricoles du centre du Mali, par exemple, celles qui se plaignent d’être marginalisées du fait de l’influence des pasteurs dans les cercles politiques. Ce favoritisme serait dû aux élites politiques qui possèdent de grands troupeaux dont l’entretien est assuré par des pasteurs rémunérés ; un phénomène courant dans toute la région Soudano Sahélienne.
Opérant dans des zones reculées et en marge de l’autorité de l’État, les pasteurs sont rarement en mesure de défendre efficacement leurs intérêts ou de contester la politique de l’État par des voies officielles. Ils manquent souvent d’expérience directe du processus législatif et de familiarité avec la gouvernance participative. Soutenir la formation d’organes représentatifs pour aider les pasteurs à défendre leurs intérêts est un point de départ. Les associations professionnelles de pasteurs sont déjà présentes dans la plupart des pays soudanosahéliens. Cependant, ces associations et d’autres réseaux de la société civile, peuvent manquer de connaissances techniques pour mener à bien des réformes législatives sur des questions complexes telles que le régime foncier ou peuvent servir principalement de plateforme pour les chefs traditionnels plutôt que de représenter les diverses voix de tous les pasteurs de leur réseau.

Dans l’ensemble de la région soudano-sahélienne, les associations professionnelles et les réseaux de la société civile s’efforcent de combler le fossé entre les prises de décisions politiques centralisées et les populations pastorales éloignées. Les réseaux de la société civile travaillent dans l’optique de combler le fossé entre les décisions politiques centralisées et les populations pastorales éloignées. Fondé au Burkina Faso en 1998, Le Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA) est l’un de ces réseaux qui sert à la fois de point focal pour la diffusion d’informations sur la gestion du bétail aux groupes de pasteurs membres, et de conseiller des institutions locales et nationales sur les politiques ayant un impact sur les pasteurs. Au Nigeria, le Forum sur les relations entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria (FFARN) réunit des universitaires, la société civile et les représentants des associations d’éleveurs et d’agriculteurs pour partager des recherches et mener des actions de plaidoyer conjoint. Le FFARN a servi de plateforme aux voix de la société civile pour produire des analyses locales des politiques fédérales et de l’État nigérian, et pour conseiller les décideurs politiques au Nigeria et à l’étranger sur les dynamiques locales du conflit entre agriculteurs et éleveurs.
Avec un corpus limité de recherches empiriques et peu d’opportunités pour les femmes pastorales de partager leurs perspectives avec des audiences nationales et régionales, les autorités gouvernementales et les humanitaires manquent souvent de preuves de première main pour guider leurs politiques et leurs programmes. Améliorer la compréhension du rôle des femmes et des normes de genre en soutenant la recherche menée localement et l’inclusion des femmes dans les activités de diplomatie publique est un point de départ essentiel.
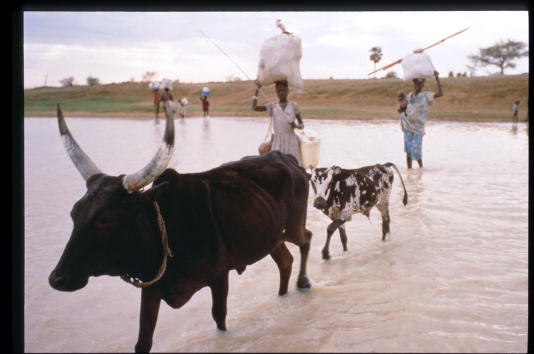
En 2010, un groupe de femmes pastorales de 32 pays (dont le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et le Niger) s’est réuni à Mera, en Inde, afin de consolider la reconnaissance de la voix des femmes dans l’élaboration des politiques liées au pastoralisme et de lancer un appel mondial à l’action. La déclaration de Mera qui en a résulté appelle les gouvernements à accepter 23 points, dont la reconnaissance du rôle des pasteurs dans la préservation de l’environnement ; une garantie de l’égalité des droits des femmes pastorales ; la création de politiques spécifiques pour améliorer les modes de vie pastoraux ; et permettre la représentation égale des femmes pastorales. La Déclaration était un concept novateur, car c’était la première déclaration de ce type à se concentrer spécifiquement sur le rôle des femmes pastorales, mais il n’est pas encore certain qu’elle ait effectivement catalysé un changement de politique dans la région soudano-sahélienne.
Alors que les éleveurs et les agriculteurs ont longtemps maintenu des pratiques coutumières ou informelles pour la médiation des conflits, ces pratiques ne sont pas toujours appropriées ou adéquates pour rendre justice dans les conflits liés au pastoralisme. Au Soudan du sud, par exemple, certains ont affirmé que les mécanismes traditionnels de compensation pour les actes de vol ou d’homicide se sont effondrés car les élites ont accumulé de si grands troupeaux que les paiements habituels liés au bétail n’ont plus le même impact.[1] Les systèmes de justice coutumière peuvent également être mal adaptés pour aider les populations traditionnellement marginalisées, comme c’est le cas pour les victimes de violences sexuelles et sexistes (voir Module 5 – Genre et autonomisation des femmes).
Pourtant, en l’absence de tiers de confiance pour traiter les plaintes relatives aux dommages causés aux cultures, au vol de bétail ou aux agressions, les éleveurs et les agriculteurs cherchent de plus en plus à se faire dédommager en usant de violence.
L’accès aux mécanismes de justice formels est souvent limité dans les zones rurales et reculées où vivent et opèrent les pasteurs. Les institutions judiciaires de l’État peuvent ne pas être présentes, leurs procédures peuvent être peu familières et elles peuvent avoir une capacité limitée à faire appliquer leurs décisions. Lorsque l’État exerce un contrôle, les crimes liés au pastoralisme peuvent être confiés à un large éventail d’autorités (forces de sécurité, administration municipale, tribunaux coutumiers) qui ne travaillent pas en collaboration et ne suivent pas les mêmes procédures. À court terme, les interventions externes peuvent contribuer à combler ces lacunes par le biais de tribunaux mobiles ou de programmes visant à établir un consensus entre les différentes autorités locales.
[1] N. Pendle, ‘“The dead are just to drink from’ : recycling ideas of revenge among the western Dinka, South Sudan,” Africa 88, 1 (2018) : 99-121.
La décentralisation est une stratégie de réforme du secteur public utilisée par certains États soudano-sahéliens pour accroître l’autonomie des communautés locales, frustrées par des années d’exclusion systématique de l’autorité politique. Le transfert de l’autorité administrative sur les ressources naturelles du gouvernement fédéral au gouvernement local crée idéalement une plus grande responsabilité envers les intérêts locaux. Cependant, le fait de confier le contrôle des couloirs de migration ou des réserves de pâturage aux conseils villageois locaux n’entraîne pas automatiquement une gouvernance plus inclusive de ces ressources. Les interventions qui soutiennent la décentralisation doivent être conçues pour aider à réconcilier les règles et coutumes concurrentes dans la gouvernance des ressources et mettre en place des pratiques de gouvernance participative accessibles aux populations mobiles.

La longue histoire de gouvernement centralisé du Mali depuis l’époque coloniale a été inversée en 1992 avec une nouvelle constitution annonçant des réformes administratives majeures qui ont décentralisé le contrôle et la gestion des services publics, y compris des terres L’objectif était d’accélérer le rythme du développement rural en accordant aux autorités infra-nationales une plus grande autonomie en matière de ressources locales, d’infrastructures, d’emplois et de croissance, tout en l’unité nationale. Tout en promettant un contrôle local plus grand sur le budget, la planification, la politique et la prestation de services, le passage de la théorie à la pratique a nécessité des années de délibérations parlementaires pour rédiger, approuver et transférer les responsabilités légales aux communes locales nouvellement créées. Ces réformes n’ont toutefois pas réussi à tenir compte des lois coutumières concernant la propriété et l’accès à la terre, ce qui a donné lieu à une concurrence entre les partisans de l’État et l’autorité traditionnelle.